- Accueil
- Centre de ressources
- Livret Plan Nature en ville
Livret Plan Nature en ville
Préface d'Antoine Picon, directeur de recherches à l'École des Ponts ParisTech et professeur à la Graduate School of Design de l'Université Harvard, directeur en 2024 de l’exposition NATURES URBAINES, UNE HISTOIRE TECHNIQUE ET SOCIALE 1600- 2030, présentée au Pavillon de l’Arsenal à Paris
La nature en ville, une histoire plus que jamais d'actualité
Jamais la question de la nature en ville ne s'est posée de manière aussi urgente qu'aujourd'hui, au carrefour de préoccupations de santé publique, d'une biophilie de plus en plus répandue, de la promotion de la biodiversité et de la nécessité d'adapter les espaces urbains aux effets du changement climatique. Cette actualité brûlante ne saurait toutefois faire oublier la longue histoire dont elle constitue l'aboutissement. La place de la nature en ville a été en effet discutée depuis longtemps ; elle a fait l'objet de multiples expériences et réalisations. Nos débats actuels doivent quelque chose à cette histoire.
Dès la seconde moitié du XVIIe siècle, des jardins royaux comme les Tuileries à Paris ou Hyde Park à Londres ouvrent leurs portes au public. Mais c'est au XVIIIe siècle que se précisent deux des principaux objectifs de la nature en ville. Cette dernière devient synonyme de santé. À ses bienfaits physiques s'ajoute un bénéfice moral. La nature pacifie et civilise ainsi que le théorise Jean-Jacques Rousseau dont la pensée influence de nombreux édiles des Lumières.
Tout en continuant à souscrire à cette conviction d'un bénéfice à la fois physique et moral de la nature en milieu urbain, le XIXe siècle l'articule à une forte dimension technique. Cette technicité se manifeste notamment dans les parcs et jardins du Paris de Napoléon III et Haussmann, dont la conception et la réalisation sont assurées pour partie par des ingénieurs, ou encore à Central Park à New York, qui nécessite d'importants travaux d'infrastructure. La nature en ville s'interprète dès lors comme un équipement aussi indispensable que les réseaux d'eau et d'assainissement, d'éclairage et de transport qui voient le jour au même moment.
Bienfaits physiques et moraux, dimension technique : sur ce canevas de base demeuré pertinent jusqu'à aujourd'hui, se sont greffées à partir de la seconde moitié du XXe siècle de nouvelles préoccupations comme la réparation des dégâts environnementaux causées par l'homme. La végétalisation d'anciens sites industriels, comme ceux de la Ruhr en Allemagne, témoigne de l'importance prise par la notion d'une nature réparatrice. Celle-ci se trouve également mobilisée pour requalifier des restes d'exploitation minière ou des décharges publiques.
En lien avec l'urgence climatique, se sont enfin rajoutés des impératifs de préservation de la biodiversité. Mais nos attentes à l'égard de la nature en ville n'en demeurent pas moins les héritières de l'histoire que l'on vient de brosser à grands traits. Il n'est pas sans intérêt de noter que le Jean-Jacques Rousseau amoureux de la nature est aussi l'un des principaux théoriciens du contrat social. Comment vivre ensemble aujourd'hui ? Comme à l'époque des Lumières, la question de la nature en ville rejoint celle d'un lien social que l'on cherche à revitaliser.
Informations complémentaires
Auteur
Ministère de la Transition Ecologique
Écrit le
2024
Date de publication
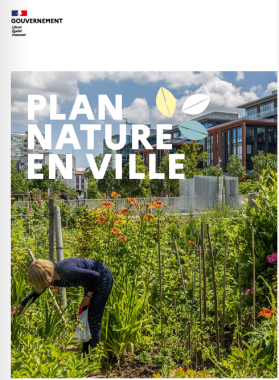
Autres documents
Liens utiles